Une destinée connue de tous que nous souhaitions illustrer non par une biographie traditionnelle mais au travers d’un hommage rendu par Alain Delon le 11 Juin 1982 peu de temps après sa mort.
Tous deux se rencontrent en 1958, se fiancent un an plus tard et furent les amants mythiques de La Piscine. Au-delà de leur séparation et du décès énigmatique de la belle Romy, l’estime et l’affection d’un des plus grands acteurs du cinéma français restent intacts : la preuve par cette lettre.
11 juin 1982
“Je te regarde dormir. Je suis auprès de toi, à ton chevet. Tu es vêtue d’une longue tunique noire et rouge, brodée sur le corsage. Ce sont des fleurs, je crois, mais je ne les regarde pas. Je te dis adieu, le plus long des adieux, ma Puppelé. C’est comme ça que je t’appelais. Ça voulait dire « Petite poupée » en allemand.
Je ne regarde pas les fleurs mais ton visage et je pense que tu es belle, et que jamais peut-être tu n’as été aussi belle. Je pense aussi que c’est la première fois de ma vie - et de la tienne - que je te vois sereine et apaisée. Comme tu es calme, comme tu es fine, comme tu es belle. On dirait qu’une main, doucement, a effacé sur ton visage toutes les crispations, toutes les angoisses du malheur.
Je te regarde dormir. On me dit que tu es morte. Je pense à toi, à moi, à nous.
De quoi suis-je coupable ? On se pose cette question devant un être que l’on a aimé et que l’on aime toujours. Ce sentiment vous inonde, puis reflue et puis l’on se dit que l’on n’est pas coupable, non, mais responsable… Je le suis.
A cause de moi, c’est à Paris que ton cœur, l’autre nuit, s’est arrêté de battre.
A cause de moi parce que c’était il y a vingt-cinq ans et que j’avais été choisi pour être ton partenaire dans « Christine ».
Tu arrivais de Vienne et j’attendais, à Paris, avec un bouquet de fleurs dans les bras que je ne savais comment tenir. Mais les producteurs du film m’avaient dit : « Lorsqu’elle descendra de la passerelle, vous vous avancerez vers elle et lui offrirez ces fleurs ». Je t’attendais avec mes fleurs, comme un imbécile, mêlé à une horde de photographes. Tu es descendue. Je me suis avancé. Tu as dit à ta mère : Qui est ce garçon ? ». Elle t’a répondu : « Ce doit être Alain Delon, ton partenaire… ».
Et puis rien, pas de coup de foudre, non. Et puis, je suis allé à Vienne où l’on tournait le film. Et là, je suis tombé amoureux fou de toi. Et tu es tombée amoureuse de moi. Souvent, nous nous sommes posés l’un à l’autre cette question d’amoureux : «Qui est tombé amoureux le premier, toi ou moi ? ». Nous comptions : « Un, deux, trois ! » et nous répondions : « Ni toi, ni moi ! Ensemble ! ». Mon Dieu, comme nous étions jeunes, et comme nous avons été heureux. A la fin du film, je t’ai dit : « Viens vivre avec moi, en France » et déjà tu m’avais dit : « Je veux vivre près de toi, en France ». Tu te souviens, alors ? Ta famille, tes parents, furieux. Et toute l’Autriche, toute l’Allemagne qui me traitaient… d’usurpateur, de kidnappeur, qui m’accusaient d’enlever « l’Impératrice » ! Moi, un Français, qui ne parlais pas un mot d’allemand. Et toi, Puppelé, qui ne parlais pas un mot de français.
Nous nous sommes aimés sans mots, au début. Nous nous regardions et nous avions des rires. Puppelé… Et moi j’étais « Pépé ». Au bout de quelques mois, je ne parlais toujours pas l’allemand mais tu parlais français et si bien que nous avons joué au théâtre, en France. Visconti faisait la mise en scène. Il nous disait que nous nous ressemblions et que nous avions, entre les sourcils, le même V qui se fronçait, de colère, de peur de la vie et d’angoisse. Il appelait ça le « V de Rembrandt » parce que, disait-il, ce peintre avait ce « V » sur ses autoportraits.
Je te regarde dormir. « Le V de Rembrandt » est effacé… Tu n’as plus peur. Tu n’es plus effrayée. Tu n’es plus aux aguets. Tu n’es plus traquée. La chasse est finie et tu te reposes.
Je te regarde encore et encore. Je te connais si bien et si fort.
Je sais qui tu es et pourquoi tu es morte. Ton caractère, comme l’on dit. Je leur réponds, aux « autres », que le caractère de Romy était son caractère. C’est tout. Laissez-moi tranquille. Tu étais violente parce que tu étais entière. Une enfant qui devint très tôt et trop tôt une star. Alors, d’un côté, des caprices, des colères et des humeurs d’enfant, toujours justifiées, bien sûr, mais avec des réactions imprévisibles ; de l’autre côté, l’autorité professionnelle. Oui, mais il y a l’enfant qui ne sait pas très bien avec quoi elle joue. Avec qui. Et pourquoi.
Dans cette contradiction, à travers cette brèche, s’engouffrent l’angoisse et le malheur. Quand on est Romy Schneider, et qu’on a la sensibilité et le tempérament à fleur de vie, à fleur de peau, qui était le tien. Comment leur expliquer qui tu étais et qui nous sommes, nous « les acteurs ». Comment leur dire qu’à force de jouer, d’« interpréter », d’être ce que nous ne sommes pas vraiment, nous devenons fous et perdus. Pour rester debout, à peu près, comment leur dire que c’est si difficile, qu’il y faut une telle force de caractère, un tel équilibre… Mais cet équilibre, comment le trouver, dans ce monde qui est le nôtre, à nous les jongleurs, les clowns, les trapézistes de ce cirque dont les projecteurs nous dorent de gloire ?
Tu disais : « Je ne sais rien faire dans la vie, mais tout au cinéma… ». Non, les « autres » ne peuvent pas comprendre ça. Que plus on devient un grand comédien et plus on est maladroit à vivre. Garbo, Marilyn, Rita Hayworth…
Et toi. Et moi je crie, pendant que tu te reposes et que je pleure, près de toi, que non, non, non, ce métier terrible n’est pas un métier de femme. Je le sais parce que l’homme que je suis est celui qui t’a le mieux connue, qui t’a le mieux comprise. Parce qu’il est un acteur, aussi. Nous étions de la même race, ma Puppelé, nous parlions le même langage. Mais moi, je suis un homme. Ils ne peuvent pas nous comprendre, les « autres ». Les comédiens, oui. Les « autres », non. C’est inexplicable. Et quand on est une femme, comme toi, ils ne peuvent pas comprendre qu’on peut mourir de « ça». Ils disent que tu étais un mythe. Bien sûr… Mais oui… Mais le « mythe », lui, sait qu’il n’est que ça. Une façade. Un reflet. Une apparence. il est roi, prince, héros, Sissi, Madame Haneau, la mouette… Mais il rentre chez lui, le mythe, le soir. Alors il n’est que Romy, rien qu’une femme, avec une vie mal comprise, mal reçue, mal écrite dans les journaux, assaillie et traquée. Alors, il s’use, le mythe, dans sa solitude. Il s’angoisse. Et plus il est conscient, et plus il tombe, à doses plus ou moins répétées, dans les béatitudes de l’alcool et du tranquillisant. Ça devient habitude, puis règle, puis nécessité. Puis c’est irremplaçable et le cœur, usé, s’arrête parce qu’il est trop las de battre. Il a été trop malmené et bousculé, ce cœur qui n’était que celui d’une femme, le soir, assise devant un verre… On dit que le désespoir que t’a causé la mort de David t’a tuée. Non, ils se trompent. Il ne t’a pas tuée. Il t’a achevée. Vrai que tu disais à Laurent, ton dernier et merveilleux compagnon : « J’ai l’impression que j’arrive au bout du tunnel ». Vrai que tu voulais vivre, que tu aurais aimé vivre. Vrai pourtant que tu es arrivée au bout du tunnel, samedi, à l’aube. Que tu as été seule à savoir, lorsque ton cœur s’est brisé, que c’était là le bout du vrai tunnel. Je t’écris au hasard. Sans ordre. Ma Puppelé, si agressive, si écorchée. Tu n’as jamais pu accepter et comprendre le jeu de ce métier de femme publique que tu avais choisi et que tu aimais. Tu ne comprenais pas que tu étais un personnage public et que cela avait une telle importance. Tu refusais le jeu, tous les jeux auxquels cette profession expose. Tu te sentais attaquée, percée, violée dans ton intimité. Tu étais toujours sur tes gardes, comme un animal poursuivi, « forcé » comme on le dit d’une biche. Et toi, tu savais que le destin, d’une main, t’ôtait ce qu’il te donnait de l’autre.
Nous avons vécu plus de cinq ans l’un près de l’autre. Toi avec moi. Moi avec toi. Ensemble. Puis la vie… Notre vie, qui ne regarde personne, nous a séparés. Mais nous nous appelions. Souvent. Oui, c’est exactement ça : nous nous lancions des «appels ». Ensuite, en 1968, ce fut « La Piscine ». Nous nous sommes retrouvés, pour travailler. Je suis allé te chercher en Allemagne. J’ai connu David, ton fils. Après notre film, tu es ma sœur, je suis ton frère. Tout est pur et clair entre nous. Plus de passion. Mieux que cela : notre amitié de sang, de ressemblance et de mots. Et puis ta vie et, sur tes traces, le malheur et l’angoisse, l’angoisse… Ils diront, les « autres » : « Quelle actrice ! Quelle tragédienne ! ». Ils ne savent pas que tu es cette tragédienne, au cinéma, parce que tu l’es dans ta vie et que tu le paies très cher. Ils ne comprennent pas que les drames de ta vie personnelle rejaillissent sur l’écran, plus tard, dans tes rôles. Ils ne peuvent pas deviner que tu es « bonne » et « géniale », au cinéma, parce que tu vis la tragédie, à côté, et que tu es bouleversante parce que t’éclairent les reflets de tes drames personnels. Et que tu ne rayonnes que parce qu’ils te brûlent. Oh ! ma Puppelé ce travail de douleur ! Est-ce que j’ai vécu avec toi ou à côté de toi ?
Jusqu’à la mort de David, pourtant, il y a « le métier » qui t’a tenu la tête hors de l’eau. Puis David est parti… Et le métier n’a plus suffi. Alors je n’ai pas été étonné quand j’ai appris que toi aussi tu t’en été allée. De quoi ai-je été étonné ? De ton non-suicide. Mais que ton cœur ait craqué, non. J’ai dit : « C’était ça, le bout du tunnel ».
Je te regarde dormir. Wolfie, ton frère, et Laurent entrent dans la chambre. Je parle avec Wolfie. Nous nous souvenons de cette maison que j’avais, à la campagne. Des dobermans qui te faisaient si peur. Nous nous en souvenons encore… C’était il y a vingt-cinq ans, en Bavière, dans un petit village. Wolfie avait quatorze ans, moi vingt-trois et toi vingt. Nous avons ri quand on nous a annoncé la visite de la présidente du Fan Club Romy Schneider en France. Nous avons vu arriver une grande jeune fille, avec des lunettes, timide, et qui s’appelait Bernadette. Quand nous sommes revenus à Paris, nous lui avons téléphoné. Elle est devenue notre secrétaire, pendant six ans. Elle est toujours la mienne, depuis vingt-deux ans maintenant.”




















































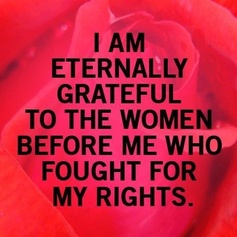




Derniers commentaires